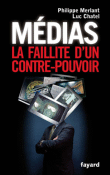
« Médias : la faillite d’un contre-pouvoir »
Le livre de Philippe Merlant et Luc Chatel qui vient de sortir aux éditions Fayard est sans complaisance. Il décrit par le menu l’abandon par la presse d’une grande partie de ce qui faisait sa grandeur : sa vocation de contre-pouvoir.
« Médias, la faillite d’un contre pouvoir » est un livre important et courageux qui ne fera pas plaisir à la corporation. Les auteurs nous invitent à rentrer dans les coulisses où se fabrique l’information. Ils expliquent avec une sévérité intentionnelle comment la presse a abandonné certains de ses principes et de ses règles, au risque de perdre son indépendance.
Mais leur objectif n’est pas seulement de pointer du doigt les dérives d’une profession mais d’ouvrir des pistes vers un journalisme réconcilié avec son public.
Recoupant plusieurs enquêtes, les auteurs soulignent d’entrée de jeu que le baromètre de la confiance des lecteurs est loin d’être au beau fixe. Les Français se méfient des journalistes qu’ils accusent d’être dépendants des pouvoirs financiers ou politiques. Le livre décrit un monde endogame où les directions de la rédaction sont fascinées par le pouvoir. Il souligne les connivences entre hommes politiques et journalistes qui se transforment souvent en relations conjugales ou extra-conjugales. Sans compter les renvois d’ascenseurs et complaisances entre collègues qui se sont mutuellement rendus services. Et une très faible capacité à l’autocritique : « En France, jamais aucun directeur de rédaction ni aucun journaliste n’a démissionné de son poste après avoir commis (et reconnu) une faute grave« .
Ce climat de faiblesse éthique, le manque de vigilance et d’exigence fait que la presse ne représente plus un vrai contrepouvoir. Le pouvoir politique est ainsi tenté de reprendre en main ce territoire, comme le montre nombre d’exemples d’atteinte à l’indépendance de la presse. Concentration croissante, pressions diverses, convocations judiciaires, placements en garde à vue, perquisitions, l’année 2007 a été particulièrement vive en remous. Tout cela est démontré. Mais c’est dans les coulisses du métier, dans son fonctionnement propre, que la critique est le plus éloquente.
Parmi les constats faits pas les auteurs, un des plus prégnants est celui de la rivalité mimétique entre organes de presse. Ce mimétisme aboutit à une information synchrone et uniforme de certains évènements. La concurrence créé le mimétisme, notent Merlant et Chatel. Plus on est en compétition, plus on se copie, plus on s’observe. Les rédacteurs passent en effet beaucoup de temps à se lire les uns les autres, à se comparer. « C’est l’art de faire comme les autres en tout en paraissant s’en distancer ». Autant de temps qu’on ne passe pas sur le terrain.
Autre travers, le défaut de contextualisation qui empêche de saisir la portée d’un fait dans sa dimension plus sociologique. Les écoles de journalisme sont montrées du doigt. Elles enseignent les techniques de base, mais évacuent l’aspect culturel, le sens de l’information, la réflexion sur l’image, la mise en perspective. Le manque de référents culturels empêche les rédacteurs de contextualiser les faits qu’ils rapportent. Surtout ne pas trop penser ! Un peu de sémantique et d’histoire seraient les bienvenues, indiquent les auteurs. De même le journalisme tourne le dos à la science, regrettent-ils.
Mais c’est bien plus la baisse des exigences éthiques de l’enquête journalistique qui inquiète Merlant et Chatel. Des mauvaises habitudes s’installent. « Les rédactions passent de plus en plus de temps à évoquer ces questions de case, de moins en moins à pratiquer leur métier sur le terrain ». « On ne prend guère le temps de fouiller les recoins, d’explorer les marges, de perdre du temps dans les zones d’ombre où apparemment il ne se passe rien ». S’en dégage une impression de regard paresseux sur la compréhension de l’actualité. Ce regard est souvent aveuglé par la course au scoop. Ce qui se vend est l’intimité des gens, surtout celle des « stars ». Le syndrome de la « peopolisation » touche la presse dite « sérieuse ». Les portraits d’individus (Sarkozy en particulier) sont préférés aux portraits collectifs. Ca fait vendre. Exit les associations, les faits relevant de mouvements ou de coopérations collectives. Les histoires d’associations, les récits d’initiatives, les coopérations citoyennes intéressent moins. Et les auteurs d’ énumérer bien d’autres dérives dans l’évolution du métier de journaliste : suivisme, autocensure, informations non vérifiées…
Autant de défauts qui trouvent une partie de l’explication dans le manque de moyens notoires dont dispose la presse pour faire son métier mais aussi les conditions ingrates de l’exercice du métier, reconnaissent les deux journalistes. A quelques rares exceptions près, les rédactions n’ont plus la possibilité de mener de véritables enquêtes. Par manque de temps. Mais aussi manque d’argent pour aller sur le terrain. Difficile également de fournir une information qui allie pédagogie et qualité rédactionnelle. Toute l’habileté consiste à être rapide, précis et pouvoir vérifier ses sources. Les rédacteurs sont également de plus en plus dépossédés du résultat final de leurs papiers. Les articles sont soumis à la moulinette souvent racoleuse du titrage ou du chapeau exigés par l’édition. Parfois au prix du contre-sens. Et le journaliste se voit alors obligé de rendre des comptes à des sources qui ont l’impression que leur message a été tronqué.
Enfin, plus grave, la profession se paupérise. « Les revenus tendent à s’amenuiser au fur et à mesure que la longueur des articles commandés se réduit » écrivent les deux auteurs. Les pigistes sont aussi très mal lotis. On leur demande de réaliser des sujets qui demandent du temps mais qui ne pourront être publiés que dans des formats de plus en plus courts. Avec, en fin de compte, des rémunérations presque indécentes. Pour ces derniers, il faudra s’armer de patience avant de décrocher un emploi stable. Les jeunes sont les plus affectés par cette fragilité économique des médias. Moins connue est la précarité du statut de correspondant local de presse qui n’ont pas droit à la carte de presse, relève pertinemment Merlant et Chatel.
Les auteurs prennent soin de montrer que la profession s’organise pour changer les choses. Les sociétés de journalistes chargés de veiller à l’éthique, les associations de rédacteurs, se sont mobilisés récemment contre les coups portés à la presse. Les Assises internationales du journalisme ont permis de mettre les points sur les « i ». L’idée d’un Conseil de presse qui fasse œuvre de médiation et de régulation est sur les rails. Les reporters sans frontières interviennent régulièrement pour faire connaître le sort douloureux de journalistes dans le monde et pousser à l’action. Autant d’initiatives qui entendent prendre à bras le corps les problèmes posés par cette évolution. Le livre contient en filigrane nombre de pistes d’action pour construire le débat public, cultiver l’esprit critique, inciter à l’action. L ’objectif des auteurs est de décrire les critères et les conditions d’une information citoyenne, loin de l’arrogance et des postures narcissiques que le milieu secrète.
Une bonne partie du chapitre 6 est consacrée à l’expérience de Place-Publique, comme exemple de media voulant sortir le journalisme de sa tour d’ivoire. ( Philippe Merlant est l’un des co-fondateurs de notre association).
L’histoire de Place Publique (pionnier de la presse citoyenne en France depuis 1996) est en effet marquée par la volonté de réfléchir aux conditions d’émergence d’une information citoyenne qui lie le micro et le macro, tout en expérimentant des pratiques inédites d’exercice du métier. Une information qui incite à l’engagement, qui invite à l’esprit critique et donne les éléments pratiques afin que le lecteur ait tous les instruments à sa disposition : base de données d’initiatives, forum publique, réactions, conférences de rédactions ouvertes, agenda, liens et coopérations avec d’autres sites, outils pratiques pour s’impliquer dans la vie de la cité), soulignent les deux journalistes. La crédibilité de Place-Publique réside dans le fait de traiter l’actualité dans la durée en insistant sur son suivi et son historicité. Le but étant que le lecteur puisse aller plus loin dans la recherche s’il le désire. Elle se distingue par son engagement ferme et sans concession du journal à propos de faits douteux ou révoltants pouvant porter atteinte à la dignité humaine.
Philippe Merlant et Luc Chatel concluent en faisant un pari : « Les combats que chacun d’entre nous nous mènera au quotidien contre les frontières intérieures du système médiatique conduiront un jour à en perturber les soubassements ».
La condamnation de la journaliste Florence Hartmann : l’illustration d’une faillite de la presse.
Nous avons pu éprouver cette « faillite » du métier que décrivent Philippe Merlant et Luc Chatel à propos de ce qui est arrivé à notre consoeur, Florence Hartmann, victime d’un cas extrêmement grave de limite à la liberté de la presse (au droit d’informer) en Europe.
Faisant valoir l’intérêt légitime du public et des victimes à être informés, la journaliste a relaté dans un livre « Paix et Châtiment » les circonstances dans lesquelles le tribunal a délibérément effacé les passages impliquant l’Etat serbe dans les massacres de civils en Bosnie-Herzégovine durant dans les années 92-95.
L’enjeu ? Ces preuves auraient probablement permis de faire condamner l’Etat serbe pour génocide et ainsi permis aux dizaines de milliers de victimes ou à leurs familles de réclamer à la Serbie des réparations. Il apparaît que Florence Hartmann a été la seule personne mise en accusation pour avoir fait état publiquement de ces décisions confidentielles, mais qui avaient déjà été évoquées ouvertement par Belgrade et même par les juges dans le cadre d’autres affaires.
Le Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie (TPIY) l’a ainsi condamné pour outrage à la cour. Une décision inique qui contrevient à la nécessaire transparence de la justice, et à l’indispensable publicité des procédures pénales et des motivations des décisions de justice, comme le stipule respecter la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg. Florence Hartmann n’a fait que son métier.
En condamnant Florence Hartmann, le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie veut dissuader toute nouvelle critique, qu’elle émane d’anciens fonctionnaires, de journalistes et même de victimes, et se soustraire à toute responsabilité. Des Etats en Europe pourront dans l’avenir se fonder sur ce jugement pour mettre à l’amende ou en prison des journalistes qui débattront de faits dérangeants, qu’ils aient déjà ou non été rendus publics. Ceci est lourd de conséquences pour la démocratie et la justice internationale.
Il se trouve que cette affaire qui touche un point extrêmement sensible de notre métier n’intéresse personne ou pas grand monde dans les rédactions. Service minimum. Rares sont les médias qui se sont mobilisés pour défendre, à travers ce procès fait à une professionnelle reconnue, la liberté d’expression. Pire, le doute s’est insinué sur son honnêteté ou sur son opiniâtreté. « Elle commence à nous bassiner avec ses massacres de bosniaques » a-t-on pu entendre chez certains de nos confrères ignorants tout de l’affaire. Plus importantes sans doute sont les feuilletons people confondants qui envahissent les médias (Frédéric Mitterrand, Roman Polanski, Eric Besson…)
Lire notre Dossier dans le Magazine Place Publique de septembre et dans celui d’octobre 2009
Lire aussi l’article de Stephane Manier, dans Liberation 21 août 2009

